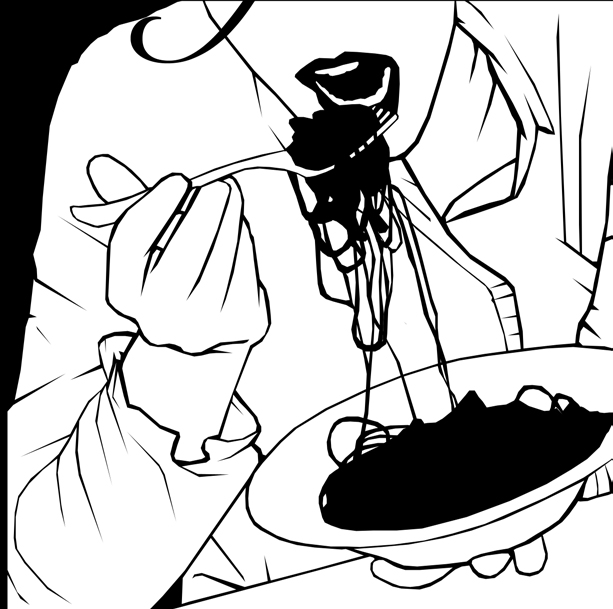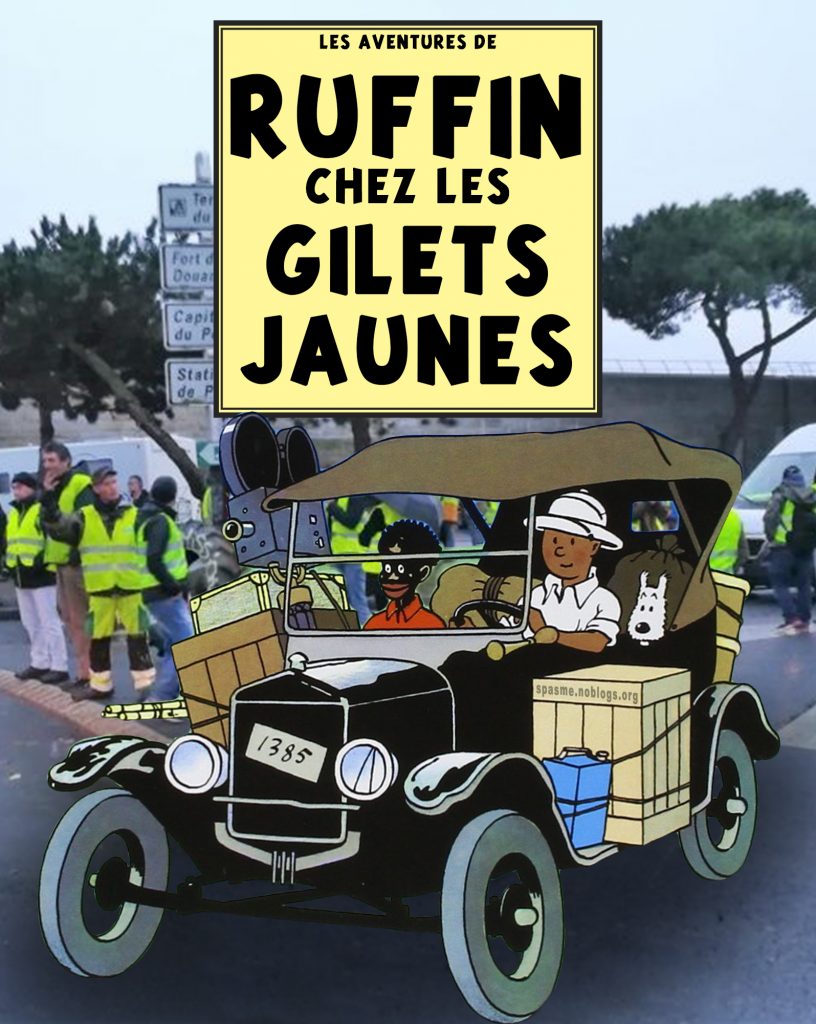Cet article est une introduction à ce qui pourrait être une étude sur les politiques de gentrification qu’a subies Avignon depuis vingt ans et qui connaissent de profondes accélérations ces dernières années. La question mériterait des discussions et un important travail de fond. Avis aux amateurs, si la question vous branche, si vous avez des pistes de réflexion ou des infos, contactez la rédaction de Spasme.
« Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les classes supérieures ont un droit vis-à-vis des classes inférieures. Je répète qu’il y a pour les classes supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les classes inférieures. »
Jules Ferry (il aurait pu le dire, non ?)
« Dans la rue on ne verra bientôt plus que des artistes
et l’on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme. »
Arthur Cravan
 La gauche et les prolos
La gauche et les prolos
En matière de gentrification, la gauche aurait-elle fait plus en une mandature (( Tout laisse à penser que la ville passera en 2020 aux mains d’un quelconque candidat LREM, soit à la suite d’un second tour l’opposant à un candidat RN, soit après une triangulaire où s’inviterait le PS.)) que la droite en plusieurs ?
Marie-José Roig, maire de droite (RPR puis UMP) de 1995 à 2014, se plaignait déjà du trop grand nombre de logements sociaux sur sa commune (trop de pauvres), du trop faible nombre de foyers imposables (pas assez de riches) et voulait « donner aux cadres envie d’habiter Avignon ». Elle s’était pour cela lancée dans la création de nouveaux quartiers (Courtine) et avait entamé un sévère nettoyage du centre-ville. Les élus parlaient alors tout bonnement de « reconquérir l’intra-muros ((Pierre, « Ici on aime les riches », Traits noirs, mai 2002, pp. 4-5.)) ».
L’équipe victorieuse en 2014, qui rassemble autour de Cécile Helle des élus PS, Front de gauche (PCF et PG) et écolo, ne se contente pas de poursuivre cet objectif et cette politique, mais vise à une profonde transformation de la ville. Elle le fait néanmoins avec beaucoup d’habileté et avec un style qui la rend, pour beaucoup, acceptable.
La droite œuvrait assez brutalement pour une bourgeoisie locale traditionnelle : réac, culturellement catholique, provençaliste, peu cultivée, commerçante et entrepreneuriale, qui aime les grosses berlines et les 4X4, etc. En perte de vitesse, celle-ci préfère de plus en plus vivre outre-Rhône, par exemple à Villeneuve-lès-Avignon, dans des villas avec piscine où l’on rêve de gated community. La gauche au pouvoir est, quant à elle, liée aux classes moyennes de gauche et à une bourgeoisie progressiste qui aime le cinéma d’art et d’essai, le théâtre, les recycleries et le vélo, qui est lgbtqui+-friendly, féministe et citoyenniste, et qui apprécie beaucoup les « quartiers populaires » pour leur exotisme et leur « authenticité »… évidemment, elle préférerait une « authenticité » qui soit bio et propre, c’est-à-dire quelque peu artificielle. Ça vient.
Le bien-être de cette fraction de la population (et des allogènes du même monde qui débarquent en juillet) nécessite un environnement culturel d’un niveau supérieur, riche, diversifié et qui, bien qu’à la pointe du politiquement correct, conserve une allure subversive, celle que donne à Avignon son image de cité du théâtre, progressiste et généreuse. Cela permet de faire vivre une flopée de travailleurs plus ou moins liés à ce secteur économique : « Tout un petit peuple de travailleurs du spectacle (techniciens, comédiens, costumières… parfois intermittents), petits patrons/proprios de salles (qui vivotent toute l’année et rackettent les compagnies parisiennes durant le Festival), de travailleurs précaires (secrétaire, chargé de diff’, de com’, etc.), associations et compagnies plus ou moins bidons, animateurs de stages, musiciens galériens, etc. Le tout survivant sur des structures perfusées aux (toujours maigres) subventions, emplois aidés, etc. et en grande partie grâce au Festival. ((Voir Clément, « Nudité et collier de chien », Spasme, n° 11, printemps 2016, pp. 40-43.)) »
La survie de la bourgeoisie de gauche est impossible sans le développement et l’entretien de cet environnement culturel, donc sans l’existence d’une masse de travailleurs vivant dans la précarité (en dépendent le fonctionnement des théâtres et la création de spectacles à bas coûts)… Par chance, la plupart d’entre eux ne s’en rendent pas compte et trouvent déjà gratifiant d’œuvrer pour l’Art et la Culture ((À noter que, dans ce monde dégueulasse, si certains ont leur statut d’intermittent (la Rolls du chômage), ils le doivent souvent au travail non rémunéré des plus précaires qu’eux (qui galèrent au RSA). Sur ces questions, on se reportera à l’article sur la grève des intermittents du spectacle de juillet 2014 : Mafalda et Valérian, « On a les chefs qu’on mérite », septembre 2014. Disponible sur https://ddt21.noblogs.org)). Le principal est d’avoir l’impression de faire partie du même monde parce qu’on a les mêmes références culturelles, la même manière d’utiliser Facebook et les mêmes valeurs (on oublie ainsi qu’on n’a pas les mêmes revenus). La beuh bio l’emporte ici haut la main sur le shit ((Obligeant les industriels de la drogue à s’adapter en cultivant des milliers de pieds de cannabis « bio » dans des coins reculés du Luberon ou de vastes locaux pour la production indoor. La culture est à ce prix.)). Mais si partager un semblant de mode de vie n’est pas partager un niveau de vie, ces petits signes de conformisme et de distinction rassurent, car ils permettent de se différencier des autres galériens des quartiers ou des bleds de beaufs (là où poussent les Gilets jaunes). Nous ne nous priverons pas de qualifier cet ensemble flou de « bobos » (terme qui, rappelons-le, vient du syntagme bourgeois-bohèmes).
Des classes dangereuses
Au temps de la grande peur… en 2014, la ville a frôlé l’élection d’un maire FN… pffff, on l’a échappé belle ! Heureusement, grâce à la mobilisation du monde culturel de gauche (du metteur en scène millionnaire ((Nous pensons, entre autres, au directeur du festival d’Avignon, le catholique queer Olivier Py, qui, il y a peu, dénonçait le lien entre le FN (sic) et les Gilets jaunes. Sur cet homme « engagé » (auprès de son ami Castaner), on lira avec profit l’article de Jean-Marc Adolphe « Les institutions culturelles sans les Gilets jaunes » (8 février 2019), sur le blog Mediapart de l’auteur.)) à la comédienne au RSA), du patronat local (cafetiers et restaurateurs en tête) et l’appui de la presse locale (quitte à s’asseoir sur la déontologie et à user de fakenews). La Cité des papes est à cette occasion devenue un bastion rose pâle dans un département où droite et extrême droite font des ravages ((Sur cet épisode, voir Clément, « Nudité et collier de chien », op. cit.)). Merci qui ?
Certainement pas la masse des prolétaires pauvres qui emplissent les cités. Pas besoin de lire les rapports de Terra Nova pour comprendre que les pauvres votent décidément bien mal… les prolos sont désormais une plaie pour la gauche (et inversement). Certes, majoritairement ils ne se déplacent pas pour voter puisqu’ils ont fini par comprendre que quel que soit le vainqueur ils sont toujours les perdants… Quant à ceux qui participent au spectacle électoral, ils ont tendance à mettre en tête le candidat du FN, c’est le cas dans la plupart des « quartiers populaires » d’Avignon, car, de nos jours, même des descendants d’immigrés maghrébins (quelle que soit leur classe) votent FN/RN ((C’est un fait majeur de cette fin des années 2010, car jusqu’alors ceux qui votaient (une minorité) le faisaient quasi exclusivement pour la gauche. Certains experts expliquent ce début de rupture par l’adoption de la loi sur le Mariage pour tous, en 2013.)). Si Tocqueville disait ne pas craindre le suffrage universel car « les gens voteront comme on leur dira », il semble que désormais beaucoup d’entre eux, notamment les plus pauvres, aient des problèmes d’audition…
Or les pauvres ne manquent pas à Avignon. Malgré un hypercentre vitrine à destination touristique, principalement bâti sur un patrimoine architectural exceptionnel, la ville concentre une grande partie de la pauvreté du département du Vaucluse… qui est l’un des départements les plus pauvres de France. Avignon connaît un taux de pauvreté parmi les plus élevés de France, autour de 30 % et un taux de chômage de 17,54 % (2015), soit environ 10 000 chômeurs dans une ville aux fortes inégalités puisque les très riches, anciennement assujettis à l’ISF, y sont plus nombreux, 347 en 2015, que la moyenne nationale.
Après des années de régression, la population augmente à nouveau et tourne aujourd’hui autour des 95 000 habitants. Parmi eux, seuls 37 % sont des propriétaires occupants (contre 60 % de moyenne nationale) ; 71 % d’entre eux habitent dans des logements collectifs (dont 17 % dans les grands ensembles) et 29 % dans des logements individuels. Quelque 32 % des habitats à Avignon sont des logements sociaux, correspondant à 80 % du parc de logements sociaux dont dispose le Grand Avignon. Enfin, il semble que près de 10 % des logements à Avignon puissent être considérés comme « indignes ».
 Du centre-ville…
Du centre-ville…
Le premier objectif des équipes municipales successives est de faire du centre-ville un quartier non mixte réservé aux touristes et à la bourgeoisie – l’ancienne (réac), qui y conserve ses hôtels particuliers, et surtout la nouvelle (progressiste), qui veut tout le reste. D’où le fait que l’accent soit mis, depuis 2014, sur la piétonnisation, les « modes de déplacement doux » et le soutien municipal à tout ce qui est bio-citoyen, politiquement correct, inclusif, culturel et artistique (spectacle vivant, art contemporain, y compris le street art), aux concept stores et ateliers d’artisans haut de gamme, etc. On gentrifie, mais de manière cool.
Le très réac Philippe Murray avait expliqué que c’était Bertrand Delanoë qui lui avait fait aimer les voitures, un bon mot que nombre d’Avignonnais comprennent peut-être aujourd’hui… certaines places paraissaient plus agréables lorsqu’elles étaient pour moitié des parkings, certaines rues semblaient plus vivantes lorsqu’elles étaient ouvertes à la circulation… Mais si la piétonnisation du centre aseptise, elle est aussi pensée pour favoriser l’éclosion de restaurants et de bars aux terrasses desquelles le prix du café s’aligne sur les normes parisiennes. De nouveaux espaces, comme la place Saint-Didier, qui, pour le maire, « constituent désormais les expériences d’achat que recherchent les gens aujourd’hui ((Les Petites affiches de Vaucluse, no 3805, 10 avril 2018.)) ». On en trouve un bel exemple, bien qu’assez caricatural, avec Le Nid, qui, depuis juin 2018, combine cantine bio-machin, sale de yoga et boutique d’objets design made in France « recyclés et recyclables » (hors de prix) visant à « mettre en avant les savoir-faire français » dans une « démarche à la fois citoyenne et écoresponsable », blablabla. Un nid de bourgeois qui bénéficie d’une double page de pub gratuite dans le journal municipal, ce qui prouve que nos élus lui attribuent du potentiel. On nous y explique que le lieu « prône la slow life », que l’on peut s’y « offrir une pause urbaine dans un environnement zen et lumineux » et y « consommer autrement » (c’est-à-dire comme ses semblables)… On comprendra qu’il est peu adapté à une pause entre un rendez-vous à Pôle emploi et un passage à la CAF. à quelques pas, c’est la place des Corps-Saints, autrefois populaire, qui va recevoir une nouvelle couche d’enduit « jeune et urbain » ; la ville y a acquis un bâtiment (entre l’église et la chapelle) pour en faire une résidence hôtelière avec espace de coworking et un bar à cocktails en rez-de-chaussée…
Deux ou trois autres projets doivent encore contribuer à donner une image cool-friendly qui siéra fort bien au futur maire LREM.
Tout d’abord, la transformation de l’ancienne prison Sainte-Anne, dont les travaux ont récemment débuté. Située au nord du centre-ville, derrière le palais des Papes, et désaffectée depuis 2003, le bâtiment, en partie classé, que l’ancienne équipe municipale voulait transformer en hôtel quatre étoiles, combinera diverses fonctions : 72 logements de (différents) standings avec parking en sous-sol, commerces, espace de coworking, restaurant, crèche, « friche » artistique, etc. Les prétendants se bousculent pour participer à cette grande conspiration culturelle.
Vient ensuite un double projet : LaScierie et Ecobio, qui, bien qu’en dehors des remparts, sont liés au centre-ville, et derrière lesquels on trouve le même personnage, l’homme d’affaires et urbaniste Jean-Pierre Gautry ((Jean-Pierre Gautry (75 ans), gérant de la SCI Ecobio, a ouvert un cabinet d’urbaniste à Avignon dans les années 1980 ; il est aussi, à l’époque, l’un des fondateurs de Biocoop en Vaucluse. Président d’honneur de la Société française des urbanistes, il a soutenu le projet de tram en Avignon au temps de Marie-José Roig avec son association Atouts Tram. On le retrouve encore autour du projet de transformation de la prison à travers l’association des riverains du quartier Banasterie, qu’il préside.)).
Le projet Ecobio, sur l’emplacement de l’ancienne Biocoop (route de Lyon à 200 mètres des remparts), se présente comme un « village bio » de paille et de bois… En fait, c’est un imposant bâtiment de 10 000 m² qui mêlera location d’appartements et activités économiques : commerces, restauration, bureaux, salle de spectacle, ferme urbaine (au sommet de l’édifice sous une serre photovoltaïque) et parking souterrain ! Ecobio sera un lieu « bioclimatique, biosourcé, producteur d’énergie » à « haute performance environnementale » proposant un « modèle économique innovant, responsable, social et solidaire pour la transition énergétique », blablabla. Au-delà de la paille et du bois, la construction sera à la pointe de la high-tech bio, et innovera avec « la conception d’un micro data center décentralisé », le « stockage d’électricité hybridé hydrogène et batterie électrochimique » et l’utilisation d’un « logiciel auto-apprenant optimisant les flux de l’îlot (énergie, eau, chaleur, ventilation, déchets organiques) ((https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ecobio-appelprojet.pdf)) ». Parmi ses partenaires, on trouve la start-up Zent (Zero Energy Network Technologies), qui se donne pour objectif de « remettre l’humain et l’environnement au cœur des systèmes et des technologies ». Un projet à 19 millions d’euros (dont 2,8 d’aide de l’État via le Programme d’investissement d’avenir) qui devrait être opérationnel à partir de 2021. Le business de la transition écologique dans toute sa splendeur ! Mais, preuve de la bonne volonté des promoteurs immobiliers et des financiers, un arbre sera conservé entre deux ailes du bâtiment ! Gautry soutient « l’idée d’écopolis, défendue par le rapport Attali. Des villes et des quartiers propres, intégrant technologies vertes et de la communication […] Gautry les imagine multipolaires et connectées, économes en ressources, équipées en services, riches en possibilités de découvertes, de rêve et d’évasion ((Olivier-Jourdan Roulot, « Jean-Pierre Gautry Urbanplayer », Cote Magazine, n° 115, novembre 2008, p. 64.)) », blablabla. Philip K. Dick n’avait pas imaginé que Blade Runner puisse être bio, il aurait dû prendre de la drogue. Quant aux dizaines de milliers d’Avignonnais mal logés, ils vont sans doute apprécier d’avoir le droit de passer devant ce « village vertical dans lequel on vit, au sens large du terme, on se nourrit avec du local bio, on va au spectacle, on réside dans un logement sain ((Jean-Pierre Gautry à La Provence, 18 juillet 2018.)) ».
Le projet LaScierie (boulevard Saint-Lazare, sur l’emplacement d’une ancienne scierie en face des remparts), « lieu de vie » multidisciplinaire de 3 300 m2, se déploie depuis 2018. On y trouve : les nouveaux emplacements de la Biocoop et du studio de danse/yoga/bien-être (les cours de yoga à la sauce Feldenkrais de Marie-France Gautry, la femme de Jean-Pierre) ; quatre salles de spectacle pour s’en mettre plein les poches pendant le festival, prévoyant, dès l’ouverture, un partenariat avec le festival « in » (la programmatrice du lieu est Mathilde Gautry, la fille, chorégraphe et danseuse), auxquelles s’ajoute une inévitable cantine-guinguette bio ; les locaux de Citiz Autopartage, une « innovation écologique et citoyenne » (voitures en libre-service) ; et les bureaux vauclusiens de la Cress (Chambre régionale d’économie sociale et solidaire).
Si pour l’extra-muros la mairie prétend « promouvoir systématiquement des formes urbaines qui optimisent le foncier et qui favorisent le “vivre ensemble” », on a l’impression qu’il s’agit plutôt de promouvoir le « vivre entre semblables » au sein du centre-ville. Là ne restent pour les pauvres que quelques îlots d’insalubrité (entre la rue du Portail-Magnanen et la place des Corps-Saints, par exemple) et des apparts dégueulasses, dont les locataires n’auront bientôt plus les moyens de boire un café ou une bière en ville, ni d’y faire leurs courses. Raus !
… à Saint-Ruf
En ce qui concerne la transformation du quartier Saint-Ruf (axe d’entrée sud de la ville), nous avons déjà évoqué, dans les numéros précédents de Spasme, la lutte des habitants pour éviter la fermeture du bureau de poste du quartier, les travaux du Tram ou l’installation a priori anodine d’une cantine bio-machin-paysanne, qui nous paraissait au contraire significative des changements à venir. Nouvelle confirmation de cette tendance avec, dans le sud du quartier, l’ouverture d’un atelier/galerie de sérigraphie par deux ex-graffeurs… La fonction des artistes n’est plus a démontrer dans les processus de gentrification ((On l’a vu par exemple à Marseille, autrefois au Panier puis ces dernières années entre la Plaine et le cours Julien.)) ; gageons que d’ores et déjà des crapules cultureuses reluquent les vieux ateliers et hangars pour les transformer en théâtres. Nous pensons que l’offensive lancée par la municipalité (et la bourgeoisie locale) pour s’emparer de ce quartier a marqué un tournant car, pour la première fois, la politique de gentrification investissait l’extra-muros. Il est vrai que, trop à l’étroit dans le centre-ville, le festival « in » (l’officiel, le subventionné) avait aussi jeté une tentacule entre les quartiers « populaires » de Champfleury et de Monclar (classés en zone urbaine sensible) avec la construction puis l’ouverture, en 2013, de La FabricA, une salle de spectacle titanesque et lieu de répétition et de résidence du festival, venue prendre la place d’un collège rasé… « pour l’occasion », diront les mauvais esprits. Avec quelques ateliers théâtre pour enfants, les associations de quartier peinent à repeindre de social ce qui n’est qu’une occupation territoriale au profit des loisirs de la bourgeoisie (« parisienne », diront les esprits chagrins), et qui en annonce d’autres.
Vers le Grand remplacement !
Il s’agit désormais de voir grand, et l’équipe municipale réfléchit à la situation de la ville en 2030, qui aura sans doute passé le cap des 100 000 habitants. Avec la communauté d’agglomération, elle a décidé de mettre en œuvre et d’accompagner un vaste projet de renouvellement urbain qui, après plusieurs années d’études, a été présenté au public en juillet dernier. Son objectif affiché est le « vivre ensemble ». Dans plusieurs quartiers extra-muros, Rocade, Saint-Chamand, Reine-Jeanne et Grange d’Orel, soit pour environ 25 000 Avignonnais, ses premiers effets devraient se faire sentir dès 2024, et les travaux, se terminer en 2030. Ce n’est sans doute qu’une première offensive.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), auquel participe financièrement l’État, via l’Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU), à hauteur de 115 millions d’euros ; la commune d’Avignon investit 70 millions d’euros sur un coût global de 300 à 400 millions d’euros. Cela sera-t-il suffisant pour gaver les patrons du BTP ?
Ces plans s’appuient sur le prolongement de la LEO ((La LEO (Liaison Est-Ouest) est un projet de voie express (en partie réalisé) qui contourne Avignon par le sud, détruisant au passage les meilleures terres agricoles de la région et les zones vertes au sud de la ville.)) et la prochaine mise en place du tramway et de bus à haute fréquence, tous devant désengorger la rocade et « apaiser et requalifier les quartiers traversés ((« Le Plan local d’urbanisme d’Avignon. Avignon 2030, inventer la ville de demain », Agora des conseils de quartier, 11 février 2017, p. 32 : http://www.avignon.fr/fileadmin/Documents/pdf/ma-ville/urbanisme/agora_plu.pdf.)) ». Il s’agit donc de favoriser le « vivre ensemble » dans ces quartiers, c’est-à-dire détruire des immeubles d’habitations, en rénover certains et en construire de nouveaux (de standing supérieur), donc modifier la composition sociale de ces quartiers, très majoritairement occupés par des prolétaires pauvres (à 60 % sous le seuil de pauvreté) et souvent issus de l’immigration maghrébine. Les responsables parlent de « la dé-densification du logement social en favorisant les parcours résidentiels et en permettant l’accueil d’une nouvelle population ((Grand Avignon Mag, n° 34, été 2018, p. 21.))… » (85 % des habitats sont des logements sociaux dans les zones concernées).
Cela va demander un important travail pour que des familles de classes moyennes acceptent de s’installer dans ces quartiers. On comprend dès lors l’intérêt qu’il y a à terminer le chantier de la LEO et mettre ainsi un terme à l’incessant trafic de camions qui, depuis des dizaines d’années, provoque chez les riverains une sur-fréquence de pathologies graves, notamment des cancers, ainsi qu’une consommation accrue de neuroleptiques ((Philippe Paupert, « Circulation : davantage de cancers sur la rocade d’Avignon », francebleu.fr, 28 février 2019 : https://www.francebleu.fr/infos/societe/davantage-de-cancers-sur-la-rocade-d-avignon-1551188894.)) (le passage des camions dans le quartier devrait être interdit à partir de 2021). On prévoit d’ores et déjà la démolition de 600 à 800 logements sociaux (25 % du parc de la ville), la réhabilitation de 1 500 autres et la construction d’environ 500 logements privés. Si le projet doit permettre des opérations d’accession à la propriété, le nombre de logements sociaux reconstruits devrait être équivalent à celui de ceux détruits, mais ils seront localisés à 70 % dans les autres communes de l’agglomération. Même si la complexe question du relogement doit se régler au cas par cas ((« Je ne sais pas comment on va faire passer des habitants qui ont des loyers modestes chez nous, chez des bailleurs sociaux où les loyers sont plus élevés », se demandait en décembre 2017 Michel Dejoux, directeur général de Grand Avignon Résidences. https://www.tpbm-presse.com/2018-annee-du-renouvellement-urbain-en-vaucluse-2092.html.)), on voit qu’il s’agit ni plus ni moins que d’un vaste transfert de population.
La fonction même de l’équipe municipale lui impose de gérer la ville pour les intérêts de la classe capitaliste ; c’est la règle. Une masse trop importante de chômeurs et de pauvres n’a pas d’intérêt pour les projets de développement urbain et économique qui sont présentés ou qui sont encore dans les cartons du patronat local. Ils deviennent même gênants, d’autant qu’ils votent mal. Dans une ville aussi férue de théâtre, on a sans doute médité cette phrase du pleutre Brecht : « Puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. » Si Avignon veut garder sa spécificité de ville « de gauche », ouverte sur la culture, le bio-citoyen et les biotechnologies vertes (pôle de compétitivité Agroparc), elle se doit en effet de créer de nouveaux quartiers branchés, des îlots de gentrification concentrée ((Des projets d’éco-quartiers existent aussi.)) pour attirer des couples de jeunes cadres/techniciens dynamiques (qui se croient « de gauche » parce qu’ils sont végan ((Évidemment, le phénomène Macron vient un peu brouiller les cartes puisqu’il courtise le même électorat (qui, en définitive, ne fait pas la différence entre Jaurès et Barrès) et que la gauche est en pleine déconfiture. Mais les projets de gentrification évoqués ici, bien que « de gauche », sont tout à fait LREM-compatibles.))…). Mais pour cela il faut de la place, et elle doit donc se débarrasser de ce trop-plein de prolétaires inutiles (mieux vaut les disperser dans les bleds du coin qui, à tous points de vue, sont déjà perdus)… et dont le mode de vie ne correspond de toute façon pas au niveau des « trois libellules » qu’a obtenues la ville au concours 2018 des Capitales françaises de la Biodiversité… Sans cela, on ne se verra jamais décerner les « quatre libellules » !
Voilà le grand remplacement de population planifié, une nouvelle catégorie d’habitants va, à terme, être implantée dans ces quartiers dont on aura extrait une partie des autochtones (les prolétaires les plus pauvres), nouveaux venus qui, tel qu’ils l’ont fait en centre-ville, vont imposer leur culture frelatée et leur mode de vie faussement bohème… beurk.
Sitting Bull reviens, ils sont devenus fous !
Clément

Pour aller plus loin…
Une ville idéale
(South Park, épisode 3, saison 19, 2015)
Ceux qui ne savent pas ce que sont les logiques à l’œuvre dans la gentrification, ni d’ailleurs ce qu’est la gentrification, n’ont qu’à regarder cet épisode quasi mythique de la série South Park.
Suite à la campagne anti-immigrés menée par le fourbe M. Garrison dans l’épisode précédent, la ville de South Park est ridiculisée. Les élites locales espèrent redorer son blason en obtenant l’implantation d’une chaîne de produits bio, Whole Foods Market. Pour favoriser ce projet, elles lancent un programme immobilier d’ampleur : la création d’un quartier à destination des bobos et des hypsters, à la place d’une banlieue poubelle où ne vivent que des familles de white trash… et notamment celle de Kenny, qui, sous son sweat-capuche orange, a une âme de gilet jaune. Alors que leur maison délabrée, si « typique », attire des hordes de jeunes cadres qui en apprécient le « charme rustique », le père de Stan rassure celui de Kenny : « On gentrifie, tout va bien ! » Whole Foods Market reconnaît n’avoir jamais « vu une ville dépenser autant d’énergie à afficher une forme exagérée de conscience sociale » et qu’elle mérite bien son hypermarché bio ! Trey Parker et Matt Stone, créateurs de la série, posent à travers cet épisode assez jubilatoire une question de fond : pour une reconquête territoriale bio-citoyenne « les balles sont-elles bien en métal recyclé » ?
 Touche pas à la femme blanche !
Touche pas à la femme blanche !
(1974, Marco Ferreri, 108 mn)
Ce film franco-italien de Marco Ferreri (La Grande Bouffe) est une reconstitution loufoque et grinçante de la bataille de Little Bighorn (1876), où Sioux et Cheyennes mirent en déroute l’armée américaine et où le colonel Custer trouva la mort – l’objectif était alors de chasser les Indiens de leurs terres sacrées, les Black Hills, où on avait découvert de l’or.
Cette parodie de western est tournée dans des décors naturels… en plein cœur de Paris, dans ce qu’on appelle alors « le trou des halles », le gigantesque chantier de destruction des anciennes halles et de leur quartier. Les scènes d’expulsion d’Indiens sont tournées au milieu de bulldozers et pelleteuses en action démolissant les immeubles où résidaient jusqu’alors les prolos du ventre de Paris.
Le travail des urbanistes et des promoteurs immobiliers n’est pourtant pas simple… Car, pendant que Custer (Marcello Mastroianni) flirte avec une infirmière (Catherine Deneuve) près de la fontaine des Innocents, qu’un artiste-vétérinaire (Darry Cowl) réquisitionne une école pour en faire une galerie où il expose des « Indiens hostiles embaumés », que Buffalo Bill (Michel Piccoli) fait sa promo, que la CIA exécute des opposants, que le général Terry (Philippe Noiret) tripote sa fille et lit Marx…, Sitting Bull (Alain Cuny) organise, lui, la résistance à la gentrification ! Pourtant, lorsque les Indiens entrent victorieux dans la ville, on comprend bien qu’« il y aura beaucoup d’autres Custer à tuer » !
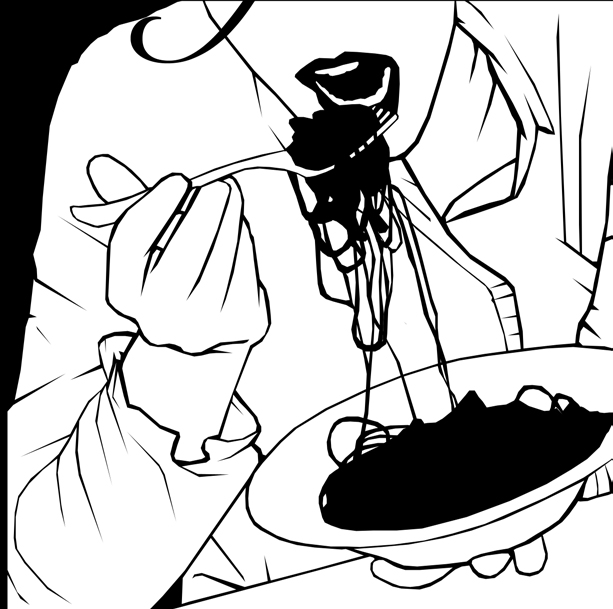 The Housing Monster. Travail et logement dans la société capitaliste
The Housing Monster. Travail et logement dans la société capitaliste
(Prole.info, Niet éditions, 2018, 164 p.)
Traduction d’un ouvrage anglo-saxon devenu référence, The Housing Monster est, sous des airs de beau roman graphique, rien moins qu’une introduction à la théorie marxiste en langage clair et direct.
L’angle d’approche est celui du logement, traité depuis l’organisation pratique du travail dans le BTP et le quotidien des ouvriers jusqu’à l’organisation capitaliste de la ville, la spéculation immobilière, les projets urbanistiques et la gentrification, mais le cœur en reste le salariat : « Notre hostilité face au travail ne découle pas de nos idées politiques. Elle vient du fait que nous sommes exploités en tant que salariés. Nos intérêts sont en contradiction directe avec ceux de l’entreprise. […] Notre travail n’est pas une expression de nos vies mais quelque chose qui nous éloigne d’elles. Nous devons passer notre temps à travailler pour quelqu’un d’autre afin d’exister pendant notre propre temps libre. Nous avons besoin du travail autant que nous le détestons ». Du très concret jusqu’à ce qui peut paraître le plus abstrait : l’usage des drogues pour supporter le taff, la fierté du travail bien fait, le genre, les SDF, les logements sociaux, les squats ou bien le capital fictif et la crise économique. Car « une maison, ce n’est pas seulement quatre murs et un toit. Depuis sa conception et sa production jusqu’à la façon dont elle est vendue, habitée, revendue et finalement démolie, cette baraque ne cesse d’être traversée par des conflits. Depuis le travail sur le chantier jusqu’au quotidien du quartier, forces économiques impersonnelles et conflits très personnels se nourrissent mutuellement. Du béton, de la ferraille, du bois et des clous. De la frustration, de la colère, de la rancœur et du désespoir. Les tragédies individuelles reflètent une tragédie sociale infiniment plus large ».