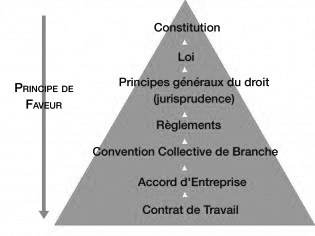Encagoulés de tête des manifs, blocages, syndicat de combat, grève générale et port spatial, mélange d’images pour cocktail équatorial, bizarre. Entre mars et avril 2017, la Guyane est paralysée par une lutte sociale d’une ampleur historique et qui plus est, victorieuse. Réjouissant non ? Le mouvement est toutefois assez éloigné de l’image qu’on peut se faire d’une grève générale…[1]
La Guyane, qu’es aquo ?
Idéalement devrait se trouver ici un tableau complet de la Guyane, stat’s à l’appui, mais nous nous bornerons à quelques éléments qui nous semblent significatifs pour comprendre ce qui s’est passé [2].
À plus de 7 000 km de la métropole, entre le Brésil et le Suriname, la Guyane est grande comme le Portugal mais peuplée comme la ville de Montpellier ou l’agglomération avignonnaise – 250 000 habitants. En comparaison, pour une superficie plus de deux fois inférieure, la Bretagne compte 3,5 millions d’habitants. L’essentiel de la population est concentré le long des 300 km de côte où se trouvent les quatre principales villes : Cayenne (55 000 hab.), Saint-Laurent-du-Maroni (45 000 hab.), Matoury (30 000 hab., dans la banlieue de Cayenne) et Kourou (25 000 hab.).
Département français d’outre-mer depuis 1946, le territoire acquiert en janvier 2016 le statut particulier de collectivité territoriale de Guyane (CTG). La Guyane, colonie à mauvaise réputation, est longtemps restée sous-exploitée et sous-peuplée ; un retard d’investissement estimé à trente années qui explique la faiblesse des infrastructures routières, scolaires ou sanitaires. Mais elle a aujourd’hui trois intérêts majeurs : sa situation stratégique, les éventuelles ressources de sa zone économique exclusive et le centre spatial de Guyane (CSG). Ce n’est qu’à partir de l’installation de ce dernier, dans les années 1960, que le territoire connaît une véritable croissance ; le centre emploie aujourd’hui plus de 1 500 salariés et induit 7 500 emplois indirects à travers 200 entreprises ; un total de 9 000 postes, qui représente 16 % de la population active de la Guyane et 30 % de la masse salariale (en 2011). C’est une manne pour un secteur du BTP très dépendant des marchés publics – sont construites en ce moment les infrastructures pour Ariane 6. Face à ce géant, les filières bois et aurifères pèsent peu, d’autant que, autre spécificité, le foncier est détenu à 90 % par l’État (et non par des communes ou des particuliers), ce qui freine les projets immobiliers et d’infrastructure.
La quasi-absence d’industries implique que tout est importé de métropole, d’où des prix particulièrement élevés (ce commerce est entre les mains d’une poignée de familles bourgeoises antillaises, souvent des békés martiniquais). Autre conséquence, un taux de chômage frisant officiellement les 24 %, les 55 % pour les jeunes. Pour caricaturer on peut dire que les Guyanais vivent du CSG, du BTP, de la fonction publique et du RSA.
Cerise sur le gâteau, une violence et une insécurité endémiques en font le département le plus meurtrier de France (42 homicides en 2016).
Et les Guyanais ?
Le département est très peu peuplé (25 000 hab. en 1945),mais il connaît une forte croissance démographique à partir des années 1990.
L’une des particularités de la Guyane est la logique ethnique très prégnante, qui tend à assigner les personnes à un groupe où une ethnie [3], par exemple les Amérindiens (10 000 hab.) ou les Bushinenges (descendants de Noirs marrons ayant fui la Guyane hollandaise à partir du xviie siècle, environ 65 000 hab., soit 26 % de la population). Deux groupes, qui ne recoupent que très imparfaitement les oppositions de classes, se distinguent historiquement :
– Les « Européens », environ 15 % de la population (on y fait la différence entre « Guyanais blancs » et « Métros »), groupe dans lequel on trouve une large partie des classes moyennes et supérieures.
– Les Créoles, qui sont les descendants des esclaves noirs ; longtemps majoritaires, ils sont devenus au tournant du millénaire une minorité représentant environ 40 % de la population (contre 70 % à la fin des années 1970). En 2005, Christiane Taubira, l’ancienne indépendantiste alors députée, déplore un « tournant identitaire » où ce qu’elle appelle « les Guyanais » sont devenus minoritaires [4]. Mais ce n’est pas tant, comme on le craignait dans les années 1970, à cause de l’afflux de « colons blancs » qu’à celle d’une très importante immigration clandestine [5].
Si la Guyane compte des groupes issus de migrations plus anciennes, comme les Laotiens (Hmong), arrivés à la fin des années 1970, c’est surtout depuis la fin des années 1990 que Brésiliens, Haïtiens, Dominicains, Guyaniens et Surinamais migrent en grand nombre. Car, si la Guyane souffre de chômage et de précarité, son PIB par tête est bien supérieur à celui de certains pays voisins. Les flux sont croissants en provenance d’Haïti (surtout depuis le séisme de 2010), du Suriname, du Guyana, et du Brésil notamment depuis l’arrêt des chantiers liés à la Coupe du monde de football (2014) et aux Jeux olympiques (2016), qui ont jeté au chômage des milliers d’ouvriers. Les immigrés clandestins, dont beaucoup vivent dans des bidonvilles sur des terrains squattés à la périphérie des villes, seraient environ 35 000 aujourd’hui (20 % de la population).
C’est, semble-t-il, à partir de 2005 que l’on a commencé à voir des groupes d’habitants manifester contre l’immigration et parfois détruire des squats de migrants (tout comme à Mayotte).
Ça bout !
On l’aura compris, en Guyane, le contexte est toujours tendu. L’année 2016 est émaillée d’une série de mobilisations hétérogènes : le collectif des Iguanes de l’Ouest contre les coupures d’électricité, les syndicats de la santé contre la situation sanitaire et financière alarmante des hôpitaux de Cayenne et de Kourou. Ce dernier, le centre médicochirurgical de Kourou (CMCK) est géré par la Croix-Rouge, qui annonce début mars 2017 sa vente à un groupe privé ; salariés et usagers se mobilisent et créent le collectif des Toukans de Kourou.
Mais c’est aussi le patronat qui est en lutte, depuis décembre 2016, dans le cadre de négociations qui, avec la collectivité territoriale, l’opposent à l’État : sur un projet d’investissement étatique de 600 millions d’euros visant à combler les retards structurels, le Medef demande une rallonge de 2 milliards d’euros et la rétrocession de 200 000 hectares de terres. De quoi relancer l’activité des entreprises locales, surtout du BTP, et de ceux qu’on désigne en Guyane sous le nom de « socioprofessionnels » (dirigeants de PME, agriculteurs, transporteurs routiers, patrons d’auto-écoles, artisans, etc.). À condition que les grands groupes ne s’emparent pas des marchés.
De ce point de vue, la question des transporteurs routiers est sensible : 130 entreprises (300 camions) ne vivent quasiment que des commandes publiques, mais les appels d’offres avantagent les deux ou trois plus grandes qui peuvent répondre aux besoins des géants du BTP ; l’UGTR (Union guyanaise des transporteurs routiers), principale organisation des « petits », est en guerre contre les « gros » (en juin 2016, ils bloquent les chantiers Eiffage et Ribal-TP).
Les agriculteurs sont, eux, en conflit depuis plusieurs mois avec leur administration en raison du non-paiement de certaines subventions.
Les Frères
À ces questions liées à l’action de l’État dans le territoire et à l’accès aux services publics va s’ajouter celle de l’insécurité. Le 15 février, à la suite d’un énième meurtre à Cayenne, un groupe fait son apparition : les « 500 Frères contre la délinquance » ; il faudrait voir dans ce nom les « frères des victimes », mais aussi une référence au film 300, de Zack Snyder. Ce qui frappe c’est évidemment leur allure : ils portent des cagoules, s’habillent de noir et circulent en groupe, les muscles en avant, pour des actions spectaculaires mais « non violentes » ; associant drapeaux français et guyanais, leur logo représente deux pistolets et un poignard entrecroisés. À leur tête un groupe de cinq hommes dont on ne connaît alors que trois visages : le « président », Stéphane Palmot (agent à la mairie de Cayenne), José Achille (patron d’une entreprise de pêche de 15 salariés) et Mikaël Mancée (policier en disponibilité depuis le 1er février).
Ce dernier, porte-parole du groupe, explique qu’« un voleur mort, c’est un voleur qui ne vole plus ». Les 500 Frères exigent que les autorités mettent fin à la violence, et demandent un renforcement de la répression policière (effectifs, vidéosurveillance, construction de commissariats, installation d’un scanner contre la drogue à l’aéroport, etc.) et l’instauration d’un système de « grands frères » dans les quartiers. La délinquance est pour eux liée à l’immigration illégale, d’où la revendication que les prisonniers étrangers purgent leur peine dans leur pays d’origine et que l’État démantèle les squats de migrants. Fort de leur connaissance du terrain, les 500 Frères se proposent d’aider les policiers, mais se disent prêts, le cas échéant, à mener ces actions eux-mêmes.
Moins d’une centaine au départ, une partie des Frères a sans doute été recrutée dans les clubs de sport et de musculation de Cayenne (méthode classique pour constituer une milice). Si quelques rares critiques ne voient là qu’un ramassis de flics et de vigiles, le groupe prétend représenter toutes les couches de la population. On apprendra toutefois fin avril que l’un des chefs dirige une boîte de sécurité…
Les 500 Frères vont se lier à deux groupes :
– L’association anti-délinquance et antidrogue Tròp Violans, fondée en 2014, qui mène des actions de prévention dans les quartiers de Cayenne avec le soutien de la municipalité et de la CGPME. Elle est présidée par Olivier Goudet, un chauffeur de bus qui était l’un des dirigeants de l’UTG [6] de Cayenne jusqu’à sa démission en décembre 2016 (c’est à ce moment qu’il se rapproche des 500 Frères).
– Un collectif similaire, les Iguanes de l’Ouest, actif à Saint-Laurent, dirigé par Manuel Jean-Baptiste (sapeur-pompier et syndicaliste UTG), s’associe au groupe à l’occasion du mouvement de 2017.
Bien que constitué dès octobre 2016, les 500 Frères n’apparaissent publiquement que le 15 février, quand quatre-vingts d’entre eux se rassemblent dans le quartier où a eu lieu le dernier meurtre. Une semaine plus tard, ayant appelé la population à les rejoindre, ils sont plusieurs centaines, encagoulés en tête, à défiler dans les rues de Cayenne au cri de « il faut que la peur change de camp ! ». Les leaders, qui se posent en interlocuteurs entre la population et les autorités, sont alors reçus par le préfet, la chambre de commerce et les élus. Le 17 février, 500 Frères et Tròp Violans font visiter au directeur de cabinet du préfet la cité Eau-Lisette et les squats de migrants. Ils mènent également une « action dissuasive de sécurisation des lieux » sur un marché de Cayenne réputé pour ses vols à l’arraché.
L’étincelle Ségolène ?
L’annonce au début du mois de mars de la visite en Guyane de la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, du 16 mars au 18 mars (venue présider une conférence internationale sur les milieux marins des Caraïbes) est sans doute un déclencheur, mais la période préélectorale peut sembler l’occasion de faire pression. Rien ne prouve que le déclenchement d’un mouvement d’ampleur ait été préparé à l’avance, mais, outre l’aspect « sécurité », plusieurs calendriers vont se télescoper sur quelques jours.
Les socioprofessionnels, la CGPME et le Medef se mobilisent donc et, le 16 mars, érigent des barrages de camions partout où doit se rendre la ministre. Les 500 Frères organisent des rassemblements devant les consulats du Surinam, du Brésil et du Guyana (pour l’expulsion des délinquants étrangers), et font irruption en pleine conférence internationale pour interpeller Ségolène Royal. Quelque peu émotionnée par cette rencontre, la ministre écourte son séjour, non sans avoir débloqué 150 millions d’euros pour la collectivité territoriale et accepté la rétrocession de 200 000 hectares de foncier. Elle donne l’impression que le gouvernement est fébrile, et soucieux d’éviter un conflit. Beaucoup en concluent que c’est le moment d’agir. Quoi qu’il en soit, le lundi suivant sera animé.
Profitant peut-être de l’annonce de la visite ministérielle, l’UTG d’EDF avait déposé dès le 10 mars un préavis de grève pour le lundi 20, demandant notamment la création de postes et de meilleures conditions de travail. Des discussions s’engagent rapidement avec la direction mais n’aboutissent pas : la grève débute donc le lundi.
À Kourou, la Croix-Rouge bachote avant de présenter, le 23 mars, son projet de privatisation de l’hôpital (le CMCK) devant le comité central d’entreprise. En prévision, le collectif des Toukans se réunit le lundi 20 au matin pour bloquer le rond-point qui mène au Centre spatial ; celui-ci fait en effet partie du conseil d’administration du CMCK ! Dans la journée, l’UTG de l’hôpital dépose un préavis de grève à compter du dimanche 26.
Hasard ? [7] Ce lundi 20, dans toute la France débute, à l’appel d’une intersyndicale, une grève des salariés de la société Endel, filiale d’Engie (pour la réouverture des négociations annuelles obligatoires). L’entreprise est présente dans le centre spatial, notamment chargée du transport de la fusée Ariane 5 du bâtiment d’assemblage jusqu’au pas de tir ; le personnel est en grève à 80 % alors qu’un lancement est prévu le lendemain.
Toujours ce lundi, ce sont les agriculteurs qui, sur leurs revendications spécifiques, bloquent la direction de l’Agriculture.
L’UGTR bloque, elle, le port de Cayenne pour s’opposer au débarquement de trois camions toupies ultramodernes du groupe Eiffage destinés au chantier d’Ariane 6.
Enfin, à Cayenne, à la suite d’un incident survenu la semaine précédente entre des salariés et le directeur de la régie, les syndicats du réseau de transports urbains (FO et CFDT) déposent un préavis pour le lendemain…
Sur le rond-point, encombré de pneus et de palettes, qui normalement donne accès au centre spatial se retrouvent donc les grévistes d’EDF, ceux d’Endel et le collectif des Toukans. Il faut ici se rappeler que Kourou ne compte que 25 000 hab. et n’est qu’à 60 km de Cayenne : on est là dans de petites villes où tout le monde se connaît et en premier lieu, les militants politiques et syndicaux. Et tout le monde sait que le lancement d’une fusée est un moment important qui, en plus, focalise l’attention des médias. C’est parti !
Le mouvement
Le lendemain, mardi 21 mars, la grève se poursuit à Endel, et le report du lancement d’Ariane 5 est un coup de théâtre qui donne un écho médiatique international à la crise. Les 500 Frères arrivent à leur tour sur le barrage de Kourou. La grève des bus démarre, et l’UTG de la Caf dépose à son tour un préavis.
Le 22, tout se précipite : l’UTG annonce une journée d’action pour le vendredi mais l’UTG-Éducation appelle à une grève à partir du lundi 27. De leur côté les grévistes d’Endel-Guyane obtiennent très vite la satisfaction de leur revendication (une revalorisation des salaires dont le montant reste confidentiel), mais restent en grève pour soutenir leurs potes d’EDF.
Ce qui se déroule dans la soirée est assez flou [c’est dommage] : les 500 Frères, une « coordination de Kourou » et les socioprofessionnels se réunissent et décident du blocage du territoire.
Le lendemain matin les camions de l’UGTR forment une quinzaine de barrages. Les préavis de grève se multiplient, et le collectif Pou Lagwiyann dékolé (« Pour faire décoller la Guyane ») est constitué. Deux jours plus tard, le samedi 25, l’UTG appelle à la « grève générale illimitée » à partir du lundi [8].
Le territoire va alors connaître plusieurs semaines de forte paralysie, ponctuées de séances de négociations avec le gouvernement, jusqu’à la victoire finale du 21 avril [9]. L’État finira par lâcher 3 milliards d’euros.
Pou Lagwiyann dékolé !
C’est autour de ce collectif que se structure le mouvement. Il va officiellement réunir 39 collectifs, syndicats et organisations professionnelles (certains en représentant beaucoup d’autres).
Les délégués des collectifs se réunissent en assemblée puis se répartissent en pôles thématiques. Le fonctionnement, un peu flou, ne va poser problème que lorsque des dissensions apparaîtront (cela nécessitera une restructuration, le 17 avril).
Même si la forme est vaguement démocratique, les collectifs n’y ont pas tous le même poids, par exemple la fédération du BTP et l’association de défense du djokan (un art martial local)… Le collectif des Amérindiens ne va, lui, cesser de se plaindre de sa marginalisation (sauf pour les photos ou la tête des manifs) et finira par rompre.
En fait les rapports de force et les alliances qui s’y jouent nous échappent, mais plusieurs poids lourds sont dans la place : tout d’abord le Medef, autour duquel se rassemblent toutes les organisations professionnelles de Guyane (les socioprofessionnels) bien qu’elles puissent avoir des intérêts différents (le secteur minier et celui de l’hôtellerie par exemple). Second poids lourd, les petits transporteurs de l’UGTR, aux positions incertaines mais qui contrôle les barrages. L’UTG, principal syndicat de Guyane mais connaissant une crise depuis plusieurs années, est dans une position inconfortable et fragile entre un tel voisinage et des adhérents qui sont pour certains en grève (pour des embauches et de meilleures conditions de travail à EDF ou dans la santé). Enfin les 500 Frères, qui, bien qu’axant leur combat sur l’insécurité, sont liés au patronat comme à l’UTG (ils finiront par scissionner) ; le porte-parole du collectif Pou Lagwiyann dékolé est issu de leurs rangs.
Assez paradoxalement, afin de limiter encore le poids de l’UTG, on verra le Medef demander une participation accrue des (autres) syndicats de salariés au sein du collectif. Les choses deviendront beaucoup plus claires après la victoire du 21 avril lorsque, dans l’indifférence et la solitude, des travailleurs poursuivront la grève sur quelques sites (EDF, hôpitaux, Gpar [Groupement Pétrolier Avitaillement Rochembeau]).
Les élus soutiennent le mouvement mais, contrairement à 2008, restent en retrait et ne réapparaîtront que lorsqu’il s’agira de la négociation finale (à ce moment-là tout le monde aura oublié que le collectif s’est engagé à ne rien signer avec le gouvernement sans « obtenir une approbation populaire »).
Mais que veulent-ils donc ?
Les revendications du collectif Pou Lagwiyann dékolé se trouvent compilées dans un « cahier de revendications » de 280 pages qui comprend 428 revendications ! Grossièrement classées par thèmes (l’éducation et la formation, monde économique, énergie, foncier, santé et social, sécurité, justice, peuples autochtones, sport et culture). En fait il semble qu’à la va-vite on ait demandé à toutes les associations et syndicats de salariés et de professionnels de faire remonter des revendications, d’où l’aspect fourre-tout du document et des demandes : de la construction d’un lycée à la réfection d’un chemin, de la défense d’une danse locale à l’installation du wi-fi dans un village, etc. Défense des architectes, des Amérindiens, des avocats, de la biodiversité… on trouve tout, mais il faut chercher longtemps pour trouver des revendications relevant de la « question sociale » (autrement qu’à travers la pétition d’éducateurs spécialisés)… Des syndicats de tous les secteurs participent pourtant à ce document, mais rien sur « la vie chère » (sinon dans les plaintes des hôteliers et des restaurateurs) et pas d’exigence d’augmentations de salaire. Les demandes les plus extrêmes sont peut-être celles de l’UTG de la Sécurité sociale : créations d’emplois, titularisation des emplois précaires et ouverture des négociations annuelles obligatoires. Si un mouvement aussi puissant se limite à des revendications aussi raisonnables, c’est bien que l’ennemi désigné n’est pas là… mais à 7 000 km. Il s’agit de ne pas diviser le collectif qui représente « la Guyane ».
Le gros des revendications repose donc sur trois piliers : l’argent, la construction et la sécurité (les deux premiers ne faisant qu’un et les deux derniers étant liés).
Il s’agit de demander à l’État de l’argent pour la collectivité territoriale et les entreprises, soit directement (sous forme d’aides et de dotations financières diverses, crédits, annulation de dettes, exonérations fiscales, création d’une zone franche sociale et fiscale pour les petites entreprises, etc.), soit par la relance de la commande publique (le bâtiment). Le souci étant que cela profite à ceux qui sont mobilisés et pas aux géants du BTP de métropole ; d’où la demande d’une modification du Code des marchés publics pour y intégrer « la notion de préférence locale » (un small business act). Construction d’écoles, de collèges, de lycées et d’un nouveau pôle universitaire, d’infrastructures routières, etc. Le tout profitera in fine à la population mais avant tout aux entreprises du BTP et de transports. Enfin, pour réaliser ces beaux projets immobiliers le collectif demande la rétrocession totale du foncier de l’État à la CTG [10].
Les revendications en lien avec la sécurité occupent de nombreuses pages, à la demande de syndicats de flics et de matons ou de divers collectifs citoyens locaux (dont les trois cités plus haut). Beaucoup de constructions là aussi : de commissariats, d’une deuxième prison, d’un centre éducatif fermé et d’une cité judiciaire ; et puis des effectifs supplémentaires en flics et en magistrats ; enfin, l’application de l’état d’urgence. Le lien avec l’immigration est très présent, on y retrouve la demande d’expulsion des prisonniers étrangers et « l’éradication » des squats de migrants ; les plus sournois demandant que l’hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni bénéficie d’un statut international (afin que les enfants qui y naissent actuellement de parents étrangers ne puissent pas obtenir la nationalité française à leur majorité).
Allure radicale
La forme n’est pas tout. Cagoules et barrages impressionnent, mais que se passe-t-il à côté ? Qu’en est-il de cette « grève générale illimitée » ? Si divers syndicats sont en lutte, seule l’UTG y a appelé. Il est difficile d’en connaître l’ampleur, mais elle semble limitée aux bastions du syndicat tels la fonction publique (territoriale, hospitalière), EDF et les dockers. En fait, très rapidement, une partie des administrations doivent s’arrêter à cause du blocage, en premier lieu l’Éducation nationale, qui, dès le 23 mars, ferme tous les établissements pour ne les rouvrir que le 2 mai. Il y a donc des gens mobilisés dans les manifs ou sur les barrages, mais ce ne sont pas forcément des grévistes au sens strict. Davantage que la grève, ce sont les barrages routiers qui paralysent la Guyane et gênent l’activité économique, c’est-à-dire ceux qui travaillent !
Il ne s’agit pas simplement, comme en métropole, de compenser la faiblesse de la grève. Le barrage routier est un mode d’action habituel en Guyane, particulièrement efficace de par la simplicité du réseau routier (le long de la côte, reliant un port, un aéroport et quelques rares sites industriels). En 2008, la CTG a ainsi connu ce type de blocage.
La Rolls du barrage, c’est évidemment le camion, d’où le rôle central que joue l’UGTR (en septembre 2015, dans le cadre d’un bras de fer entre l’État et le Medef, l’UGTR avait bloqué l’ensemble des administrations). Rôle central aussi de son leader, Bertrand Moukin, un transporteur routier à la réputation d’escroc, impliqué dans une histoire de faux papiers pour travailleurs illégaux (pas dans une optique No Border). Celui qu’on appelle le « président des barrages » est le très officiel « coordinateur des barrages » du collectif Pou Lagwiyann dékolé, celui qui envoie ses consignes via un groupe What’s app et reste en lien avec la préfecture (pour les questions de véhicules prioritaires, réquisitionnés, etc.).
On comprend que dans ce contexte les barrages spontanés ou auto-organisés, « sauvages », n’ont guère de place. Si quelques-uns sont érigés le premier jour, surtout dans les « quartiers » de Cayenne et de Kourou, où il s’agit parfois de racketter les automobilistes, ils sont vite démantelés par les 500 Frères ou la police.
C’est sur cette question que vont se cristalliser les oppositions, notamment après que l’État a accepté le 1er avril un plan d’urgence de plus de un milliard d’euros qui satisfait une partie du mouvement. À l’approche du week-end de Pâques, une minorité des 500 Frères propose un renforcement des barrages (empêcher le passage des piétons, vélos et scooters), alors que le Medef pose publiquement la question de leur finalité : doivent-ils bloquer tout le territoire et donc toute l’économie, ou seulement des points stratégiques pour maintenir le rapport de force avec l’État (les administrations, le centre spatial) ? Les entreprises et les artisans commencent en effet à ressentir les conséquences du blocage (manque de marchandises, transport impossible), et beaucoup ont recours au chômage partiel. Le 11 avril, après quinze jours de barrages, les premières oppositions se formalisent (pétition et manifestation), notamment à l’initiative de petits patrons, et la Fédération du BTP demande au préfet de faire respecter la liberté de circulation.
Le 19 avril, alors que l’accord final est en cours de rédaction, une partie de ceux qui ont aidé à la mobilisation comprennent qu’en fin de compte ils ne vont pas gagner grand-chose : les Toukans et des grévistes du CMCK et d’EDF tentent de bloquer l’accès à la zone industrielle de Kourou (semble-t-il épargnée jusque-là). Mais il est trop tard, les transporteurs ont repris le travail, et l’activité économique redémarre.
La question des barrages est aussi, évidemment, un souci quotidien pour les Guyanais, qu’ils continuent à travailler ou pas. Leur fonctionnement et leur fermeté varient tout au long du mouvement : on laisse passer les urgences, les gens qui ont des billets d’avion, les cas particuliers, les voitures le dimanche (peut-être est-ce pour la messe)… ou pas, et généralement entre 22 heures et 4 heures du matin. D’où les stratégies d’évitement, les divers
bidouillages, le système D, ou le recours au scooter.
Mais entre grève et barrages c’est la vie quotidienne qui se complique. Le port de Cayenne, où transitent normalement 90 à 95 % des importations et exportations, est à l’arrêt ; les navires sont déroutés, et 1 200 containers à destination de la Guyane s’entassent dans divers ports des pays voisins ou des Antilles (350 autres attendent sur le terminal). Le fret aérien est lui aussi interrompu (les vols passagers ne sont, eux, que perturbés, surtout les transatlantiques). Rapidement on assiste à un début de pénurie, notamment de produits frais ou de gaz (l’essence n’est que rationnée). La préfecture procède à des réquisitions de dockers, à deux reprises pour des containers de matériel médical et de médicaments, et une troisième fois pour de l’alimentation pour bétail. Quoi que les habitants pensent du mouvement, le ravitaillement devient pour eux un souci quotidien. Une radio privée proche du mouvement relaie des infos sur les stocks disponibles, l’ouverture ou non des marchés, les ventes exceptionnelles de poissons ou de fruits et légumes par des producteurs (sans intermédiaires ou revendeurs), et fait le point sur les barrages qui empêchent de s’y rendre… Et à l’hôpital de Cayenne, c’est un service de chirurgie qui doit fermer en raison du manque d’effectifs.
Quant aux cagoules on aura compris que durant le mouvement elles n’ont pas rimé avec désordre. Au contraire, la police aura pu compter sur le sérieux des 500 Frères, dont l’un des leader déclarera : « Nous avons toujours été pour le calme, nous avons toujours été du côté de l’État, en évitant que la population se soulève contre l’État »… Leurs biceps ont surtout servi à impressionner les commerçants chinois qui avaient oublié de fermer boutique un jour de manif, les automobilistes récalcitrants sur les barrages ou les petits jeunes voulant jeter des pierres sur les flics. On ne signalera qu’un seul « affrontement » entre manifestants et flics, le 7 avril, où deux policiers seront blessés… le lendemain, les chefs des 500 Frères apporteront des fleurs au flic hospitalisé. Les autorités ne signalent donc que très peu « d’incidents » durant la période et même une baisse de la délinquance ordinaire [11].
Le groupe des 500 Frères joue un rôle croissant dans le mouvement, à la fois avant-garde, encadrement, et service d’ordre ; il jouit d’une très grande popularité (certains voient en ses membres les zapatistes guyanais). Son porte-parole, le très beau et charismatique Mikaël Mancée, policier de son état, devient la star du mouvement ; son retrait, à la toute fin, sera vécu comme un drame « national ».
Un mouvement inédit ? Pas tant que cela car il rappelle les mobilisations de 1996 et surtout de 2008. Entre octobre et novembre de cette année, la Guyane a connu un puissant mouvement contre une hausse des prix des carburants qui présente bien des similitudes avec 2017 – initiative des transporteurs, extension aux socioprofessionnels, collectif citoyen aux commandes, barrages qui bloquent le territoire (durant une semaine), report du lancement d’Ariane 5… – et quelques nuances, comme le « choix » du leader (rien de moins que la présidente de la CGPME), l’implication des élus, le timide soutien de l’UTG ou les émeutes, qui, certains soirs, ont embrasé les « quartiers » de Cayenne [12].
Tout d’abord avoir en tête l’échelle. On a l’image d’un pays entier qui se soulève alors que, sur un très vaste territoire, ce sont deux ou trois villes qui grondent. À 7 000 km de distance on ne saisit alors pas tout ce qui se joue. Cela nous empêche par exemple de comprendre les intrigues et magouilles locales, les jeux de pouvoir, qui nous échappent dans ce conflit où les ego des leaders se bousculent. Ce n’est peut-être pas plus mal.
Les médias français se sont surtout intéressés au mouvement en Guyane lorsque Ségolène Royal a croisé des encagoulés ou lorsque Ariane 5 n’a pu décoller, puis, élection oblige, on s’en est désintéressé. Il en est allé différemment des médias d’extrême gauche en métropole : au début on a adoré l’appel syndical à la « grève générale illimitée » et l’érection des barrages (on en rêve tellement sous nos latitudes), certains y décelant même de « l’auto-organisation » (on a pourtant vu ce qu’il en était)… Et puis rapidement on a compris que les gars en cagoules en tête de cortège, c’était pas comme à Paris, et que le dirigeant du Medef appelait lui aussi au blocage… il y a eu comme un léger malaise. Alors, le plus souvent, on a arrêté d’en parler (même ceux qui avaient été très attentifs au mouvement de 2009 en Guadeloupe13). Poussière sous le tapis.
Ce mouvement n’est pourtant pas sans intérêt, mais la référence qui vient à l’esprit, et que sur place on ne manque pas de faire, c’est l’épisode des Bonnets rouges de 2013, qui fut sévèrement jugé par l’extrême gauche (pour son aspect interclassiste, régionaliste et populiste). Mais dès lors qu’une lutte éclate dans les DOM-TOM, on se sent obligé d’y voir un combat contre « le colonialisme » et, non sans condescendance, on préfère ne pas y porter de regard critique.
Or, l’idéologie indépendantiste « traditionnelle » est en recul en Guyane, et les militants qui la portaient s’appuyaient sur l’existence d’une communauté créole majoritaire, mais devenue minoritaire (en 2010, les rares participants à un référendum sur une autonomie accrue ont rejeté cette idée). Le mouvement de 2017 a d’ailleurs demandé une plus grande implication de l’État français dans ce territoire (vers une réelle « continuité territoriale ») y compris une présence accrue des forces et dispositifs de répression. Si on est donc loin d’une lutte de libération nationale, on y retrouve pourtant un trait caractéristique : contre un État-métropole et sur une base territoriale se dresse un mouvement interclassiste qui englobe toutes les couches de la population, avec à sa tête la bourgeoisie, et comme base et force de manœuvre, les travailleurs et les chômeurs.
Dans un tel agencement, c’est évidemment la bourgeoisie qui tire les marrons du feu. Le mouvement s’inscrit dans le bras de fer qui l’opposait à l’État depuis décembre 2016 ; elle y remporte davantage qu’elle n’exigeait initialement : plus de trois milliards d’investissements étatiques pour la santé, l’éducation et la sécurité, des aides aux entreprises (et des engagements de l’État sur l’évolution du statut ou la rétrocession de terres).
Pour utiliser à son profit (et à celui de la classe moyenne) la colère sociale, et pour la concentrer contre l’État-métropole, la bourgeoisie a surfé sur l’idée de territoire, ici de « défense de la Guyane ». Si une convergence d’intérêts existe et repose sur des réalités matérielles indéniables, cela ne fait pas disparaître la réalité des rapports de classe : tous les habitants bénéficieraient de la construction d’un nouvel hôpital ultramoderne, mais cela ne réglerait pas les dépassements d’honoraires, les soins de moins en moins remboursés, ni les accidents de travail sur les chantiers, ni le niveau des salaires ou des pensions, etc.
L’archipel multiculturel en mutation verrait-il se constituer un « peuple guyanais » (incluant opportunément les sans-papiers qui bossent sur les chantiers) ? Le flambeau indépendantiste sera-t-il repris dans le futur par une bourgeoisie locale mettant en avant une « nation arc-en-ciel » ? Il lui faudrait pour cela pouvoir s’appuyer sur un réel développement économique, à moins de se borner à tirer davantage de bénéfices du centre spatial (la location du site représenterait une rente pour un micro-État, mais ne profiterait évidemment pas à toute la population). Nous n’en sommes vraiment pas là. D’autres, plus raisonnables, imaginent tirer profit du lien avec l’Union européenne, qui fait la spécificité du territoire dans la région (notamment en matière de normes contraignantes), et rêvent d’une Guyane devenant porte d’entrée des produits européens vers l’Amérique du Sud. Il faudrait pour cela beaucoup d’investissements.
De ce point de vue, l’État est, lui, placé devant un dilemme de type « colonial »14 : soit limiter les investissements dans le territoire afin que celui-ci conserve un lien de dépendance avec la métropole – alors il y a risque d’instabilité sociale, mais les velléités d’indépendance resteraient illusoires ; soit investir dans le territoire (et détendre la situation sociale), au risque de lui donner la possibilité matérielle d’une indépendance (et donc, à terme, de perdre cet investissement). La première solution a jusqu’ici été privilégiée par la France (c’est aussi la plus avantageuse d’un point de vue comptable) ; avec les accords d’avril on s’engage peut-être vers la deuxième solution.
Les discours sécuritaires ont sans doute joué au début un rôle de liant dégueulasse (mais efficace) pour l’unité de « la Guyane » ; c’est ce qui a mis mal à l’aise les militants de gauche de métropole et a ravi les médias d’extrême droite. Éluder cet aspect, central au départ, c’est aussi ne pas voir comment il a fini par s’estomper. En fait le mouvement a pris une telle ampleur qu’il est allé bien au-delà du groupe créole (qui était majoritaire au début), agrégeant tous les habitants du territoire y compris des immigrés récents. Dans les cortèges, personne ne leur demandait s’ils avaient ou non leurs papiers. C’est très sensible dès la manifestation du 28 mars où sont brandis des centaines de drapeaux guyanais (autrefois celui des indépendantistes) mais aussi brésiliens, haïtiens ou dominicains. Un phénomène similaire s’était produit en 2008. Oui, en Guyane comme en métropole, la lutte transforme (provisoirement) ceux qui y participent, même les racistes. Les 500 Frères ont même été obligés d’infléchir leur discours en déclarant « nous sommes tous Guyanais – Brésiliens, Haïtiens, Surinamais, Guyaniens… » ou en précisant qu’ils comptaient dans leurs rangs « des Créoles, des Haïtiens, des Dominicains, des Surinamais… » et même « deux Blancs ».
Le déclenchement du mouvement de mars est par certains aspects surprenant. Il ne relève pourtant pas du hasard ou d’une « rencontre fortuite », mais d’une situation sociale particulièrement tendue qui, d’une manière ou d’une autre, avec ou sans ministre, aurait fini par éclater. Quant à la forme assez étrange qu’a prise cette explosion, il est difficile de dire si elle est liée à des particularismes locaux ou à l’émergence de nouvelles formes de lutte (notamment caractérisées par un fort interclassisme et la centralité du rôle de la classe moyenne)15. Il ne faudrait tout de même pas que désormais, pour être victorieuse, une lutte soit dirigée par le patronat ! ? Les luttes contre le patronat et contre l’État, bien que rarement victorieuses, ont nettement plus de gueule, non ?
Clément
[1] Pour de nombreux détails sur le mouvement de 2017, nous conseillons de vous reporter à la chronologie que nous avons réalisée en préparant cet article et qui est disponible ici.
[2] Si vous voulez des chiffres cherchez par exemple Guyane, rapport annuel 2015, publié par l’IEDOM.
[3] Jacques Leclerc, « Guyane française » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, avril 2017.
[4] Marianne Payot, « La bombe migratoire », lexpress.fr, 1er décembre 2005.
[5] Frédéric Piantoni, « La question migratoire en Guyane française », Hommes et migrations, n° 1278, 2009, p. 198-216.
[6] UTG : Union des travailleurs guyanais réunissant 37 syndicats professionnels. Organisation proche de la CGT française, autrefois indépendantiste mais ayant mis de l’eau dans son vin.
[7] Le choix de cette date par les syndicats du groupe Endel est peut-être lié au calendrier du CSG, mais pas à celui de Ségolène Royal.
[8] On voit bien qu’il n’y a pas à attendre que les centrales syndicales lancent un appel à la grève générale ; si elles le font, comme ici l’UTG, c’est bien que le mouvement est déjà en cours et qu’elles tentent d’en avoir le contrôle.
[9] Pour beaucoup de détails, se reporter à la chronologie.
[10] Le collectif des Amérindiens s’est plaint d’avoir été réduit au rôle de figurant au sein du collectif. Il a aussi dénoncé la « récupération d’une revendication ancestrale qui est celle de la restitution de nos terres » au profit des magouilleurs de la CTG.
[11] On ne repère que quelques actions individuelles comme des tentatives d’incendie contre le centre des finances publiques de Cayenne et contre une base de loisirs appartenant à un élu qui a initié la manifestation du 11 avril contre les barrages, et le jet de cocktails Molotov sur le domicile du directeur d’EDF (voir la chrono).
[12] Anne Catherine Ho Yick Cheong, « De la mobilisation collective de décembre 2008 en Guyane française au référendum de janvier 2010, une année de crise », Études caribéennes, n° 17, décembre 2010. Le mouvement étudiant et lycéen de 1996 avait, lui, entraîné des affrontements, incendies et dégradations en centre-ville, et provoqué une grève générale.
[13] Le blocage de la Guadeloupe qui dura quarante-quatre jours en 2009 avait pour revendications la question de la vie chère et celle des salaires, et avait entraîné des violences et des tensions.
[14] Le manque d’investissement (écoles, hôpitaux, routes, casernes, prisons) n’est pas en soi un signe d’exploitation coloniale. Si les colonies d’antan ont profité aux entreprises françaises, elles se sont révélées un gouffre pour le budget de l’État.
[15] Voir notre article « La Chose est devenue sérieuse. Notes et questions sur le mouvement contre la loi Travail », Spasme, n° 12, automne 2016, p. 36-37.
 POUR ALLER PLUS LOIN
POUR ALLER PLUS LOIN
Articles détaillant certains points mais avec lesquels nous ne sommes pas forcément d’accord :
Stéphanie Guyon, « Nou bon ké sa ! Décryptage de la grève générale en Guyane », 18 avril 2017 (sur terrainsdeluttes.ouvaton.org).
« Que se passe-t-il en Guyane ? » (entretien), 5 avril 2017 (sur paris-luttes.info).
Adrien Guilleau, « Guyane. Point d’étape sur le plus grand mouvement populaire », 5 avril 2017 (sur alencontre.org).
« Guyane, au cœur de la tempête » (sur 19h17.info)