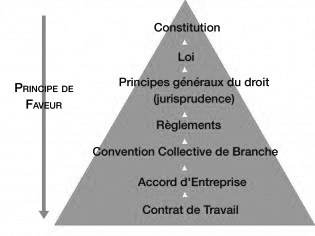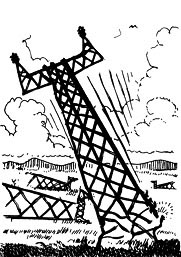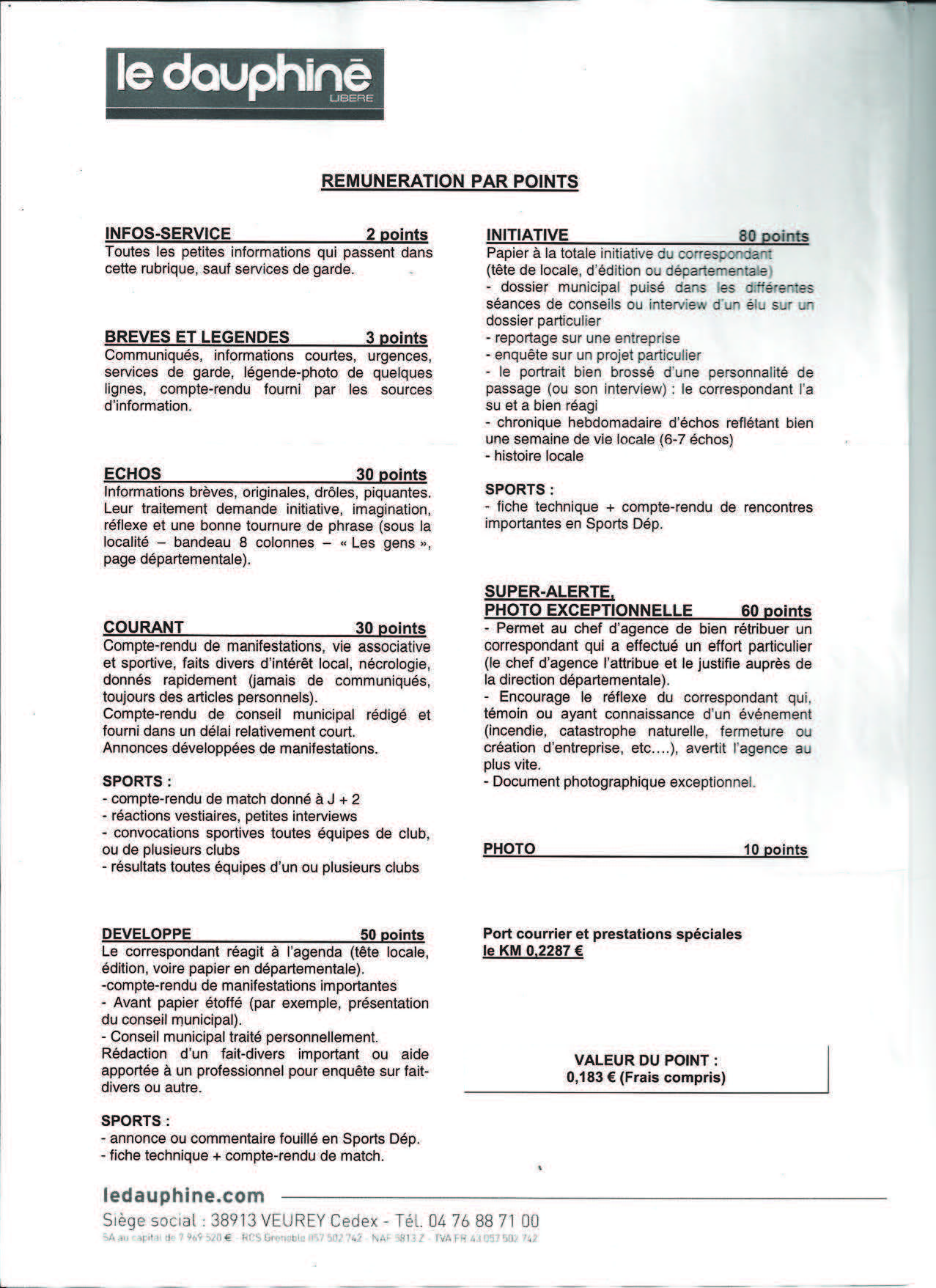Le 27 février dernier, Georges Courtois était de passage à Avignon pour participer à une rencontre organisée par le Collectif anti-carcéral du Vaucluse. C’est que le bonhomme en connaît un bout sur le sujet : il a passé plus de 30 ans en cabane. Né en 1947 dans une famille pauvre, il commence tôt à se débrouiller pour améliorer le quotidien. Ses petites rapines le font atterrir en maison de redressement et c’est là que l’escalade commence vraiment. Refusant la formation de plombier que l’administration veut lui imposer, il choisit la carrière de bandit. Plus souvent dedans que dehors, Georges Courtois se découvre alors un talent d’écrivain lorsqu’il adresse depuis sa cellule des lettres d’insultes aux magistrats qui s’occupent de son cas ou de celui de ses amis.
En 1985, il est convoqué à la Cour d’Assises de Nantes avec Patrick Thiolet afin d’être jugé pour un braquage qu’ils ont commis. Les deux acolytes ont alors l’idée folle d’organiser une prise d’otage dans le tribunal afin de dénoncer le fonctionnement de la justice et les conditions de détention dans les prisons. Pour cela ils sont aidés par Karim Khalki. Cet ancien co-detenu et ami de Courtois, libéré quelques jours plus tôt, leur apporte les armes nécessaires. Équipés de grenades et de revolvers ils prennent en otage magistrats et jurés pendant 34 heures sous l’œil des caméras de FR3. Les trois hommes finissent par réclamer les moyens de s’enfuir pour Courtois et Thiolet et une expulsion du territoire vers la destination de son choix pour Khalki. Après avoir obtenu une voiture et s’être rendu à l’aéroport de Nantes sous escorte policière, le trio, dans l’impasse, libère finalement les derniers otages et se rend. Ce coup d’audace vaut 11 ans de prison supplémentaires à Courtois. En 2015, il a publié ses mémoires, Aux marches du palais, un an après la fin d’un autre séjour de 14 ans derrière les barreaux pour un nouveau braquage.
Avec quelques camarades, nous avons profité de sa venue pour lui poser quelques questions autour d’un canon. Un entretien qui se finit en queue de poisson pour cause de timing un peu serré, mais qui nous livre un bon aperçu de ce personnage haut en couleur !
M. : Pour commencer, nous aimerions savoir pourquoi c’est important pour toi de faire des rencontres de ce type, de venir parler un petit peu de ta vie et de la prison ?
Georges Courtois : Bon, déjà c’est quand même un truc qui est relativement pesant… Et puis moi là tu vois, je sature un peu. Je me traîne un peu ça comme un boulet. À Nantes par exemple, je suis intercepté dans la rue, je sais pas, dix fois par jours par des gens. Et le problème c’est que le discours c’est toujours le même. C’est la séquence nostalgie : « J’avais 22 ans [le jour de la prise d’otage], c’est l’année où je me suis mariée ! ». Attends, la femme, elle en a 50 maintenant, c’est sa jeunesse quoi !
M. : Tu fais référence à la fameuse prise d’otage du tribunal de Nantes en 1985 ?
G.C. : Oui. Ça a été très bien reçu par la population. Alors ils viennent me voir dans les restaurants, etc… Ma femme elle voulait plus aller au restaurant à un moment donné tellement ils faisaient chier. Parce que bon ils sont chiants, quand même. C’est sans grand intérêt, quoi ! Mais c’est bien qu’ils passent quand même… Je les reçois bien. S’ils font la démarche de venir me voir c’est sympa, même si c’est pour dire des banalités.
M. : Aujourd’hui tu viens dans le cadre d’une rencontre contre l’enferment carcéral. Le principe même de la prison est très rarement remis en question. On sait qu’il ne ressort rien de bon de ce système, mais pourtant on le maintient, d’après toi comment ça se fait ?
G.C. : Je n’ai pas de solution. Je dis qu’il faudrait effectivement la supprimer, mais bon les sociologues ils sont là pour ça normalement. Personne ne s’en préoccupe. D’ailleurs, on se préoccupe surtout d’en construire d’autres. Et puis le problème qu’il va y avoir pour les prisons c’est qu’avec les partenariats public/privé, Vinci et Bouygues qui sont les rois du béton en profitent. Et ça va être géré également par le privé. Ces entreprises qui fabriquent les prisons, l’État Français leur paye un loyer, pendant 30 ans par exemple…
« …je suis sorti il y a deux ans, pendant un an j’étais dans une drôle de galère ! »
M. : Comme les autoroutes ou les aéroports…
G.C. : Voilà c’est le même système. Ils vont privatiser les prisons donc il y aura des espèces de syndic, comme dans un immeuble. Un appartement vide c’est de l’argent qui est perdu, il faut qu’il soit occupé, ça sera pareil avec les cellules. Il faudra que ça soit toujours plein. Donc ils vont en mettre de plus en plus.
C’est ce qu’ils se préparent à faire. Si tu vas voir un mec, un connard quelconque, un rond-de-cuir du Ministère de la Justice, tu lui demandes : « D’après vous il y aura combien de gens en prison en l’an 2050 ? » Il prend son ordinateur et il te dit : « Il y en aura 110 000. » C’est-à-dire qu’ils ont fait des projections ! Il pourrait te dire : « On va faire un programme politique qui fait qu’il y aura de moins en moins de gens en prison. » Mais non ! Il te dit : « Il y en aura 30 000 à 50 000 de plus » ! Le mec il le sait, et puis ça sera comme ça, hein ! Il faut construire des prisons à tout prix, même si ça sert à rien… Construire des choses qui servent à rien, c’est quand même assez aberrant !
Alors quoi faire à la place? Je sais pas…

M. : C’est compliqué, c’est lié avec le reste aussi…
G.C. : Bah, ouais…. Tu vas pas faire travailler les gens qui sont en prison. Bon, on parle pas des mecs qui vont faire trois ou quatre mois, les touristes tout ça. Mais quand tu fais des 10, 15 ou 20 ans, quand tu sors, ça craint ! Qu’est-ce que tu veux faire ? Moi je sais, je suis sorti il y a deux ans, pendant un an j’étais dans une drôle de galère ! Pas d’appartement, bon j’avais un peu d’oseille qui me restait, ça allait tu vois, mais enfin… J’avais le droit à rien, plus de sécurité sociale, enfin c’était terrible !
M. : Concernant le travail en prison justement, toi, tu as travaillé en prison ?
G.C. : Ça va pas ? Il devient fou ! Alors lui il me pose des questions, complètement… Je sais même pas ce que ça veut dire le mot travail, moi. Tu sais qu’il y a aucun patron qui peut se vanter de m’avoir fait une fiche de paye dans sa vie !
M. : Dans ton bouquin tu dis quand même à un moment que tu as essayé de finir ta formation de plombier, mais que tu as eu de nouveaux ennuis pour une histoire de carte grise…
G.C. : Ouais, quand ma fille est née. Bon j’ai eu une petite fille, la dernière, la deuxième. J’ai dit faut arrêter un peu de déconner. Ils m’ont attrapé, j’avais pas changé une carte grise, ils m’ont mis trois mois en prison. Formation ou pas formation, allez hop au placard ! J’ai dit allez ça va, c’est bon ! J’ai fait deux mois et demi, je suis reparti et j’ai repris mes activités criminelles.
Quand tu mets un mec en prison, on peut partir du principe que c’est dans un but de le faire réfléchir. Moi, quand ils m’ont mis en prison cette fois-là, j’avais déjà fait plus de vingt ans et ils m’ont mis trois mois ! Ils se sont moqués de moi ! Ça n’a aucune utilité de mettre trois mois à un mec comme moi qui a passé des années dans les centrales !
M. : Juste de quoi te faire foirer ta formation en fait…
G.C. : Oui voilà, c’était baisé. Trois mois de prison, qu’est-ce que j’en ai à foutre ! Je rentre là-dedans, je pose mon sac par terre et j’attends qu’on vienne me chercher ! Trois mois, t’as pas le temps de te retourner, t’es déjà dehors, quoi.
A. : Il y a des expériences, c’est en Scandinavie ou en Hollande, il y a des prisons ouvertes où les gars ils travaillent la terre, il y a des champs…
G.C. : Il y en a en France, en Corse à Casabianda, à Mauzac… Mais alors le problème c’est que les mecs ils ont pas trop envie de travailler quand ils sortent de quinze ans de prison. Moi je te le dis franchement, ils se précipitent pas sur les outils ! Et puis là actuellement, socialement parlant, ça craint un peu le boulot… Il n’y en a pas pour les gens normaux, alors pour ceux-là, c’est même pas la peine.
Et puis les mecs qui travaillent dans les prisons, moi j’ai jamais travaillé en prison, je te le dis tout de suite, ils sont payés au lance-pierre. Ils sont rackettés ! Ils te prennent 10 % par là, 12 % par là. En fait tu payes ton loyer quoi ! Alors moi, je travaillais pas, mais ils ont reçu une mise en demeure à la prison de l’Île de Ré pour mettre un écrivain public à disposition des détenus. Parce qu’ils amènent là-bas tous les mecs des îles : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Brésil. Tous ceux qui se font arrêter par la France là-bas, dans les Caraïbes, les îles anglaises, Sainte-Lucie et compagnie. Les mecs ils parlent plus ou moins bien le français et ils se retrouvent à 6000 kilomètres de chez eux. Donc l’administration m’a demandé : « Est-ce que ça vous dit de faire l’écrivain public ? » J’ai dit oui. Ils m’ont dit : « Bon, on vous paiera l’encre, le papier, un ordinateur », j’avais un ordinateur, « et on vous donnera 300 € par mois. C’est libre accès, c’est-à-dire vous n’avez pas d’horaires, c’est à la demande ». Des fois j’étais un mois sans faire une seule lettre.
B. : C’est balaise quand même. À l’Île de Ré maintenant ils amènent les condamnés, alors que c’était le départ pour le bagne !
A. : C’est le même bâtiment avec les descendants des mecs ! Parce que c’est très clairement les descendants des mecs.
G.C. : Avant il n’y avait qu’un bâtiment à l’Île de Ré, maintenant il y en a deux. Ils en ont fait un il y a une trentaine d’années qui est à peu près correct, mais le bâtiment d’où les mecs partaient pour la Guyane, il est au patrimoine de l’UNESCO et aux monuments de France, classé historique. Les mecs, ils reçoivent de l’eau quand il pleut ! Donc un jour l’administration a fait venir un architecte des Bâtiments de France. Mais il peut pas boucher les fuites, il peut pas y toucher. Les fenêtres elles sont toutes vermoulues, il peut pas les changer. Le lendemain, devine ce qu’ils ont fait. Je te jure, t’y crois pas ! Ils ont amené des seaux de moutarde et de mayonnaise industrielle. Des grand seaux de 5 ou 10 kilos et ils ont envoyé un mec qui fait l’entretien, un taulard quoi, mettre les seaux au plafond ! Les mecs ils ont des seaux au plafond ! L’eau elle tombe dans les seaux et ils viennent les vider. Le mec quand il dort, l’eau elle tombe en faisant : « Pof ! Pof ! »
À Fresnes aussi ils ont fait un truc comme ça, avec toutes les photos des mecs qui partaient pour le bagne. Comme dans Papillon [1] ! Les matons, le directeur, ils sont très contents d’avoir ça.
« …le bâtiment d’où les mecs partaient pour la Guyane, il est au patrimoine de l’UNESCO et aux monuments de France, classé historique. Les mecs, ils reçoivent de l’eau quand il pleut ! »
Moi quand je suis intervenu au Palais de Justice de Nantes, j’ai ouvert le feu sur la police dans la salle des pas perdus. Il y avait des gros piliers et il y a des balles qui ont ricoché. Paf ! Dans les piliers ! Le plâtre qui tombe, la balle qui se met dedans… Eh ben un jour je vais au Palais de Justice et je vois un mec avec une échelle, il gratte un pilier. « Bonjour monsieur », il me dit, « je travaille pour vous là ! – Ah bon ? – Oui, parce que vous comprenez, les impacts de balles, ils commencent à s’affaisser avec l’humidité, alors là on est obligé de les consolider. – Mais comment ça ? – Ah ! », il m’a dit, « parce qu’ils sont conservés, hein, à titre historique. – Oh ! », ben j’ai dit, « C’est formidable ! »
Non mais tu te rends compte ces gens-là, quand même, ils ont pensé à conserver les impacts de balles !
M. : Ils ont plus de soucis pour les bâtiments que pour les gens…
G.C. : Ah oui ! C’est une catastrophe !
M. : Par rapport aux conditions de vie en prison justement, dans le bouquin tu parles un peu de Badinter [2] en te moquant de ses mesures en tant que Garde des Sceaux, par rapport à la télé dans les cellules par exemple…
G.C. : Ah ben la télé elle a une histoire particulière. Tu sais que moi j’ai jamais pris la télévision en prison. Pendant 25 ans, ils m’ont jamais vu avec la télévision.
Qu’est-ce qu’ils ont fait? Ils ont mis la télé pendant un an chez les femmes. À la centrale des femmes de Rennes. Et là, les psychologues ils se sont mis au boulot. Insomnies en baisse, tentatives de suicide en diminution, enfin tout allait bien, quoi ! Forcément qu’elles dormaient bien, elles regardaient la mire à 3 heures du matin ! Donc ils ont dit que c’était une très bonne chose et ils ont décidé de mettre la télévision dans les prisons. En fait c’est thérapeutique.
La première prison qui a eu la télévision en France, c’est le 20 décembre 1985, juste avant qu’on se fasse serrer, pour que les mecs ils nous voient nous faire attraper ! La semaine d’après ils ont mis la télé partout, mais les Nantais ils l’ont eue en premier, ils ont pu être aux premières loges, c’est rigolo. Badinter c’est quelqu’un de lamentable.
M. : Tu parles aussi des procès et de leur côté très spectaculaire notamment aux Assises. Dans quelle mesure ? Tu évoques notamment le rôle des jurés.
G.C. : Ben les jurés, je les ai accusés d’être coupables d’ignorance. C’est-à-dire qu’ils viennent dans des trucs où ils ne savent même pas ce qu’ils viennent faire. Ils n’ont aucune idée de la justice franchement. Par contre, il y a une des jurées qui est venue me voir pendant 10 ans en prison.

M. : Une jurée de la prise d’otages ?
G.C. : Oui. Elle m’amenait ses enfants. Elle a divorcé et tout le bordel ! Et c’était ma gonzesse pendant 10 ans. Dans les prisons pour les parloirs il y a des appartements aménagés avec chambre, salle de bains, enfin un appartement quoi [3]. Et donc elle venait me voir là, passer deux trois jours. En réalité, on ne se voyait que pour les bons côtés, les bons moments.
J’étais un bon mec, mais moi je suis un gros con. Ma femme, elle me l’a dit. Là je suis toujours aussi con avec elle, elle m’a redit ça tout à l’heure. Elle est contente que je sois toujours aussi con, parce que comme elle est malade, tu sais, je fais attention de pas être compatissant.
Et donc, je me suis révélé un gros con quand je suis sorti du placard. Je voyais ma jurée, on continuait notre petit cinéma, mais elle m’a dit : « Bon écoute, moi non, ça va plus du tout ! » C’était plus les moments privilégiés. Et puis je pense qu’elle avait voulu s’encanailler un peu. Venir dans les prisons, ça la motivait. Mais je suis resté copain avec elle, elle a trouvé un mec et je suis resté pote. Elle est morte il y a deux ans et demi d’un cancer. Et c’est marrant parce que c’est son gendre qui m’a téléphoné à la prison pour me le dire qu’elle était morte. C’est rigolo hein ? Le mari de sa dernière fille. Elle avait quinze ans quand j’ai serré sa mère. Et voilà !
M. : En dehors des jurés, il y a aussi tous les magistrats…
G.C. : Ah non mais alors là… Moi je leur ai dit : « Le carnaval est terminé ! On enlève les habits de clown, c’est fini ! » Leurs robes rouges et tout ça ! Ils ont tout enlevé ! Karim [4] il a dit : « Mettez moi ça sous le bureau que je les vois pas ! Et vous allez vous asseoir par terre ! », il a dit « À côté de la serpillière ! » Oh quelle honte !
M. : Dans ce que tu racontes on voit que les juges ont tendance à distribuer facilement les mois de prison.
G.C. : Ah ben c’est des distributeurs, je te dis moi. Je leur écrivais des lettres d’insultes, mais des lettres d’art quand même. Pas de gros mots, tu sais. Ils voulaient plus que j’aille au tribunal. Le procureur il a dit : « Non ! Non ! Il faut plus l’appeler ce mec-là, c’est bon ! »
À Créteil, ils m’avaient mis dans une cage avec des cartons. Il y avait plein de gens de Fresnes. Et là, un magistrat me dit : « Vous êtes en représentation ? » – « Comment ? » – « Est-ce que vous êtes venu faire ici une prestation artistique ? » Je lui dis : « Mais vous êtes qui, vous ? » – « Je suis le Président du tribunal qui va vous juger. » – « Quelle-est la question ? » Il m’a redemandé : « Est-ce que vous êtes en représentation ? » – « Ça dépendra du public ! », j’ai dit. Et je lui ai fait une représentation comme quoi j’étais membre bienfaiteur de la SPA, enfin personne n’y comprenait rien et on a jamais parlé de pourquoi j’étais là. Et puis finalement il m’a mis trois mois de prison amnistiés. C’est-à-dire rien. « Vous n’êtes pas condamné, vous pouvez y aller », il m’a dit, « on vous a assez vu ! »
●
Ici s’achève l’entretien que nous avons dû écourter car la rencontre avec le public devait démarrer. À noter cependant que la revue Jef Klak, déjà évoquée dans nos colonnes, a publié dans son numéro 2 un long autoportrait de Georges Courtois (voir ci-dessous). Signalons également qu’entre notre rencontre avec Georges et la publication de cette interview nous avons appris le décès de sa compagne, Chantal. Nos pensées vont donc vers lui.
M.
_______________
1 Papillon est l’autobiographie à la véracité très controversée d’Henri Charrière qui fut bagnard en Guyane. L’ouvrage a été adapté au cinéma en 1973 par l’américain Franklin J. Schaffner.
2 Robert Badinter devint une icône de la gauche en faisant abolir la peine de mort en France en octobre 1981 lorsqu’il était ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand. À partir de là les condamnations à de longues peines de prison augmentent fortement. En 2006, des prisonniers ont lancé une pétition réclamant le rétablissement de la peine de mort qu’ils trouvaient moins hypocrite que les longues peines…
3 Georges Courtois évoque ici les « Unités de Vie Familiale » (UVF), expérimentées à partir de 2003 et censées être accessibles à tout détenu depuis 2009. Dans les faits uniquement 26 établissements sur 191 en disposaient en 2015, ce qui restreint énormément l’accès à ces dispositifs.
3 Karim Khalki, n’obtint pas l’expulsion vers le Maroc demandée durant la prise d’otage et fut enfermé pour cette dernière jusqu’en 2000. Plus d’infos sur : http://khalki.chez.com/sommaire.html.
Pour aller plus loin :
– « Autoportrait en cagoule : Georges Courtois, malfaiteur professionnel », Jef Klak n°2, mai 2015, http://jefklak.org/?p=2609.
– Georges Courtois, Aux marches du palais, éditions Le Nouvel Attila, 2015.
– Georges Courtois et les amis de Karim Khalki, Nom : Khalki, Prénom : Karim, N° d’écrou : 584K, éditions l’Insomniaque, 1999.